J’aime pas les récits de voyage.
J’ai l’impression, en les lisant, de me trouver prisonnière d’une maison en miroirs où je ne peux que regarder quelqu’un d’autre se regarder, tandis que ma présence ne déclenche rien, comme en-dessous du seuil minimal d’existence requis pour obtenir mon reflet. (Il ne manquerait plus rien que ça, pour donner suite aux échelles de grandeur des montagnes russes, que les parcs d’attraction nous tendent un miroir-test : Existez-vous assez?)
Même affaire avec les rêves. Le désintérêt qu’ils suscitent est si offensant que les profs de français au secondaire les bannissent. Les grands auteurs déconseillent de les raconter. Tell a dream, lose a reader.
La mécanique des récits de voyages est pourtant fascinante. Les paysages extérieurs révèlent les paysages intérieurs. Et même si l’auteur maîtrise à merveille l’hypotypose, pour moi, on ne peut rien assimiler d’un voyage qu’on n’a pas vécu.
C’est le principe du pot de cornichons. Quand tu rushes pour ouvrir le pot de cornichons, personne ne se contente de voir ta belle ingéniosité se révéler. TOUT LE MONDE va dire : passe-moi le (ou passe-le moi si vous parlez bien). La pulsion la plus raisonnable est d’essayer par soi-même. Faire l’expérience. En tirer nos propres opinions.
Le problème, c’est que le flop appréhendé des récits de voyage est inversement proportionnel à la rage qu’on a de les écrire. On est transformés, on veut en parler. Je me retiens de vous achaler avec mes révélations de serviette de plage ou les perles de sagesse que j’aurais trouvées dans une conque de chambre de motel bookée à la dernière minute.
Or, j’ai envie de parler de la mère en vacances, voyage ou pas. De la mère qui traîne pendant l’excursion de vélo, un quart de mille derrière le peloton des êtres chers se disputant le maillot jaune. La mère dont les blagues sont accueillies par des roulements de yeux, ou plus gentiment par le silence ; entre deux fous rires qu’une remarque du père aura fait jaillir – j’admet qu’il est vraiment drôle. Le fan club a sa star. Je ne peux pas rivaliser. La meilleure blague du monde peut naître sur mes lèvres pour aussitôt rentrer dans le mur de béton impassible du pelé et de la tondue qui se promènent avec la moitié de mon ADN. Quand, en plus, ils ajoutent à l’infamie la cruauté de se moquer de mon incapacité à puncher, je me dis :
1. Damn.
2. Ils rient de moi mais ils rient.
Ma fille souvent ajoute : T’es tellement chou, maman.
Pas drôle, mais chou.
Dans le milieu de l’humour, et selon le Scientific American, on peut parler d’un humor gap. (Comme si ce n’était pas assez décourageant d’être pognées avec un orgasm gap.)
L’humour et la capacité à faire rire font partie de l’arsenal des hommes pour séduire et réussir en société. Trouver un homme funny, c’est l’équivalent de trouver une femme pretty. Sois belle et ris de mes jokes.
Mesdames rient davantage lorsqu’elles sont en conversation avec un homme qu’avec une autre femme.
Certaines humoristes constatent que leurs prestations les disqualifient en tant que partenaire sexuelle. Une stand-up qui se produit dans les cabarets de New York depuis plusieurs années ne se fait plus d’illusions : «By the end of my gig he’s going to find me repulsive, at least as a sexual being.» Les hommes ne l’approchent pas, les soirs de show, alors que ses collègues masculins se font régulièrement aborder et inviter à sortir.
Quand on demande à des hommes et des femmes de choisir les caractéristiques d’un ou d’une partenaire dans différents types de relation, le seul endroit où les hommes vont choisir une femme funny, c’est en amitié. Quelle surprise. #not
Nous sommes si bien élevés à tenir nos genres – les garçons apprennent à faire, les filles apprennent à plaire – que ce rapport d’admiration à sens unique est gravé dans la pierre de nos inconscients. Il est drôle, elle a le sens de l’humour.
Si ce n’était que ça.
Je me rappelle qu’à l’âge qu’ont mes ados, je préférais marcher aux côtés de mon père qu’aux côtés de ma mère pendant nos sorties. Lui marchait vite, elle, lentement. Lui, arpentant le monde à pas de géant, qu’on soit dans le Vieux-Québec, dans un musée ou en forêt. Elle, l’occupant, le détaillant, le savourant sans se presser. Mon frère avait résolu que la position de premier de cordée était plus enviable que celle en bout de queue. Moi je navettais entre les pôles, parfois orbitant autour des deux gars partis en peur ; d’autres fois, prise de solidarité pour ma mère, j’adoptais sa vitesse et prenant pour mon devoir de chigner – ATTENDEZ-NOUS.
C’est choquant pareil d’avoir à feindre de t’intéresser à des écharpes en cachemire aux motifs de madame dans le Petit Champlain pour faire ralentir les meneurs, de devoir quémander le sentiment d’exister, et d’en arriver à fantasmer d’être perdue pour forcer les autres à se soucier de toi. (Disparaître – la plus extrême vengeance que puisse imaginer un enfant.)
Ma mère et moi, des satellites. Des lunes.
De retour à l’auto, mon frère et moi, on s’obstinait systématiquement pour s’asseoir derrière mon père. Fouille-moi pourquoi. En fait, pas besoin de fouiller. Mon frère shotgunnait systématiquement la place derrière le conducteur, et moi je la lui disputais pour le faire chier.
– C’est moi.
– Non c’est moi.
– La dernière fois, c’était toi. C’est mon tour.
– La dernière fois, ça comptait pas parce qu’on est allés au village. C’est même pas deux minutes.
– Ah! Un tour, c’est un tour.
Que pensait ma mère de notre acharnement à ne pas vouloir s’asseoir sur le siège derrière elle? J’aurais capoté, à sa place. Il suffit que mes enfants me fassent un sourcil d’attitude pour que je me sente exclue. Peut-être savait-elle mieux que moi distinguer la cruauté des infantilités.
J’ai mis quelques anecdotes ensemble sans savoir trop trop ce qu’elles veulent dire. Les mères, après avoir été le centre de l’univers de leurs Zamours, traversent souvent (forcément?) une phase ingrate où ils s’opposent à elle, la jugent, la sous-estiment.
Dans un repli archaïque de notre conscience, la mère, et par extension, le féminin, suscitent l’aversion ou la honte.
Le dégoût.
Le dégoût est mon nouveau dada.
J’ai trouvé, dans la bibliothèque de la maison où j’ai passé les vacances, un livre dont le titre imprimé sur l’épine m’a sauté aux yeux. The Happiness Hypothesis. Jonathan Haidt. Professeur de psychologie sociale, il a compilé tout ce qu’il a pu trouver sur les facteurs du bonheur, d’abord en fouillant la sagesse des philosophes antiques et orientaux pour y trouver des constantes, puis en écumant les études en sciences humaines afin de valider, nuancer ou complémenter ses découvertes.
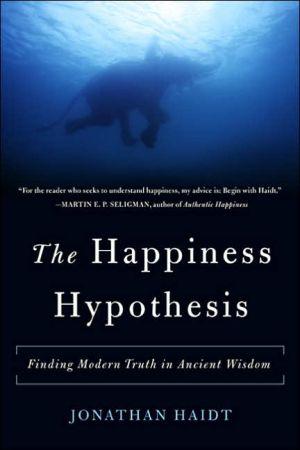
J’ai clanché le livre en trois jours, en notant compulsivement.
Un des chapitres portait sur la spiritualité.
Je ne crois pas être la seule à me demander par quelle porte entrer dans le merveilleux monde (dit-on) de la spiritualité. Ma foi et moi, on ne s’est pas vues depuis les funérailles de ma grand-mère maternelle. Hier, un chien est venu pooper sur ma galerie, direct devant ma porte, laissant des traces et des compléments de poop un peu partout. Il est où, le divin?
Justement, Haidt a découvert que le divin se révèle par opposition au dégoût. À l’autre bout du spectre. L’humain éprouve naturellement du dégoût pour les déjections, le sang, la putréfaction, la saleté et les mauvaises odeurs. Les grandes religions ont en commun de nous tendre une échelle qui doit nous éloigner au maximum de la matérialité de la terre et de la chair pour nous élever vers la Pureté. Haidt dit que le dégoût, c’est là qu’on plante l’échelle de Jacob qui mène vers la perfection divine.
Le problème, c’est que le corps des femmes, sur cette échelle construite à main d’homme, a la fâcheuse tendance à tirer vers le bas – mind the gap.
Accusé : le sang menstruel. Accusé aussi : l’accouchement, qui donne à voir le corps d’une manière choquante.
Le dégoût du féminin, et la honte qu’on impose aux femmes, a de longues, de profondes, de très sinueuses racines.
Une chance qu’on peut s’élever autrement, par les arts, la méditation, la communion avec la nature, l’observation des étoiles, et je vous laisse compléter la suite. On n’a plus à adhérer à une religion pour embrasser le sentiment de plénitude qu’elle promet, celui que les chercheurs définissent comme océanique. Telle une goutte d’eau dans l’océan, j’appartiens à un Tout puissant, qui me dépasse et me contient, et dont je suis une pure composante.
C’est juste que si on voyait derrière le dégoût, au lieu de chercher à s’en éloigner, on approcherait d’une autre vérité. Le dégoût, c’est le signe qu’on a devant les yeux les traces du travail biologique de la vie – et de la mort. Et pas n’importe quelle mort, la Mort qui est une composante de la Vie. En fondant notre spiritualité sur une adhésion océanique à la nature, on pourrait régler le cas de la misogynie religieuse et peut-être commencer à trouver divine la nécessaire protection de la Nature.
Et c’est ainsi que mes blagues pas ries ont fini en programme éco-féministe.
On a passé de belles vacances.
***
Bizarrement, je crois qu’un des moments les plus touchants de l’été est celui où ma fille a eu un accident de déclenchement de règles au stade de baseball. On avait juste les moyens du bord et notre débrouillardise pour éviter un moment gênant. Il y a eu un grand chelem, on a remercié le ciel et le frappeur de nous faire vivre de grandes émotions comme ça, et de retour au chalet, Fleur et moi, on a cherché les meilleurs tutos pour se débarrasser des tâches de sang sur un short en jeans pâle – son préféré, évidemment. On a testé le dentifrice à pâte blanche. Laisser agir 20 minutes sur le tissu préalablement mouillé. Puis frotter et laisser tremper dans l’eau froide. Résultat : parce que plusieurs heures s’étaient écoulées avant qu’on ne puisse agir, il est resté un subtil cerne brun clair, atténuable de lessive en lessive, ai-je promis.
Plus que la performance du dentifrice, c’est l’attitude de ma fille qui m’a émue. Elle n’a pas laissé l’angoisse gâcher sa soirée, elle est restée de bonne humeur entre ses sauvettes aux toilettes, avec son chandail autour de la taille qui lui tenait lieu de jupe, et elle eu le réflexe de prendre sa mère pour alliée. Tout le contraire de moi qui lavais mes culottes en cachette dans l’évier du sous-sol. Je n’aurais jamais voulu quiconque à mes côtés, ou peut-être que oui, mais il me semblait que cela ne se faisait pas. Cela ne devait pas être vu. Le sang menstruel était un tabou. Mon tabou.
À l’image du short en jeans, et grâce à ma fille, il ne reste de ce tabou que le souvenir de son empreinte.
Merci, Choupie.
